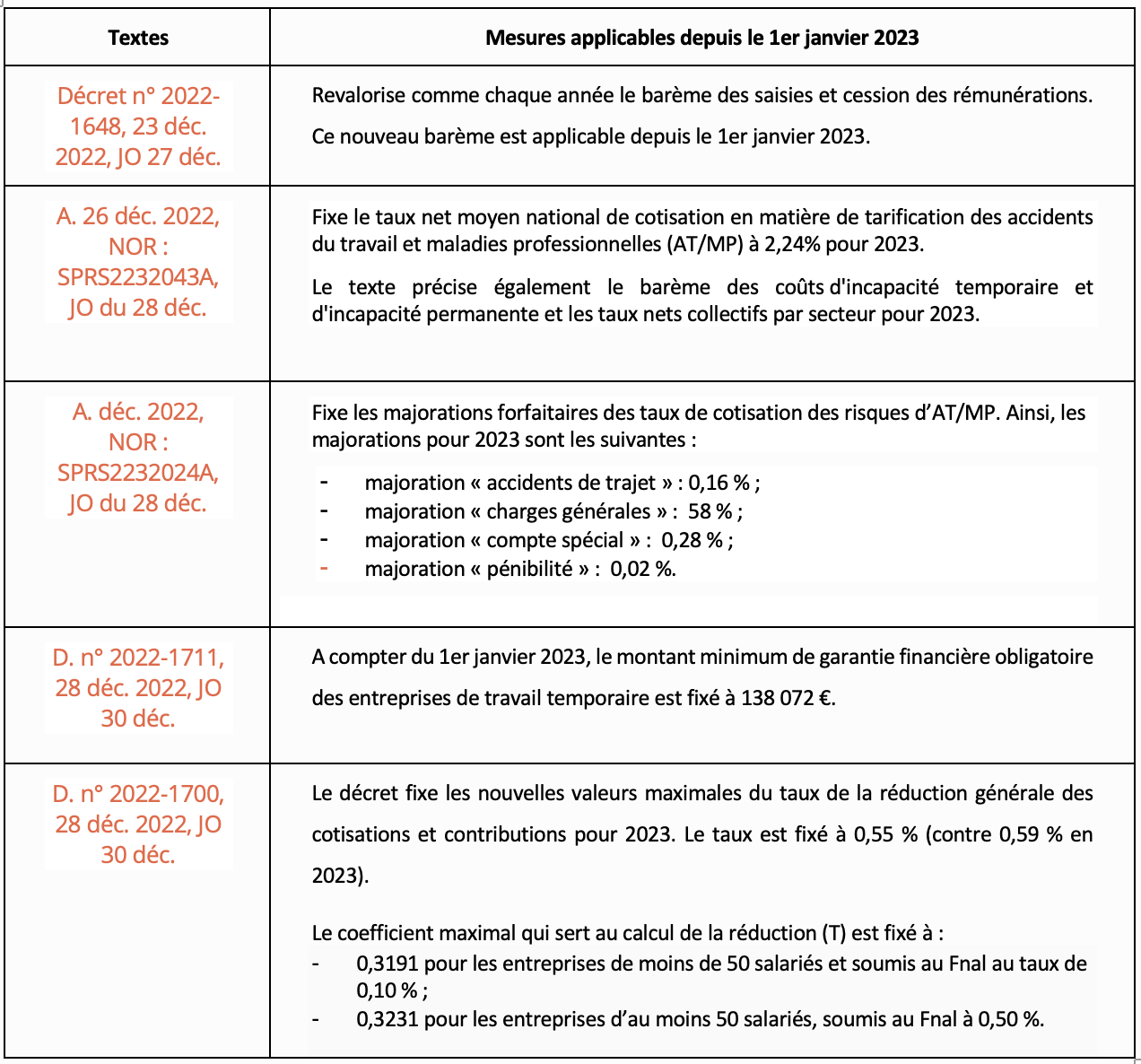Actu-tendance n° 661
Jurisprudence – Relations individuelles
Rappel : Il résulte de l’article L. 3171-2 du Code du travail que : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ».
L’employeur doit tenir à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié (art. L. 3171-3 du Code du travail).
L’article L. 3171-4 du Code du travail précise à cet effet que « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
A qui incombe la charge de la preuve des heures de travail accomplies lorsque le salarié exerce une partie de son travail sur site et une autre en télétravail ?
Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.139
En l’espèce, un salarié engagé en mars 2000 s’est suicidé sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, en mars 2014. Celui-ci travaillait 2 jours par semaine sur site et 3 jours en télétravail, depuis novembre 2013.
Suite au décès du salarié, ses ayants droit ont saisi la juridiction prud’homale en paiement des heures supplémentaires non rémunérées, de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et pour violation du droit à la vie privée et familiale.
Les ayants droit du salarié réclamaient une indemnisation au motif que l’employeur n’a pas tenu compte de la législation en soumettant son salarié à une charge de travail et managériale le conduisant à devoir travailler au-delà de l’amplitude légale de travail. Ils fournissaient à l’appui de leur demande un rapport de l’inspection du travail ainsi que des échanges de mails professionnels pour justifier l’amplitude horaire du salarié.
Les ayants droit demandaient en outre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par le salarié et demandaient aux juges de faire sommation à l’employeur de produire les relevés de badgeage, les mails envoyés et échanges avec le salarié afin de prouver que celui-ci travaillait au-delà de la durée normale.
La Cour d’appel a débouté les ayants droit en retenant que les éléments fournis démontraient que le salarié travaillait beaucoup mais ne permettaient pas de constater la violation par l’employeur de la législation sur le droit au repos dans la mesure où le salarié effectuait deux jours en télétravail à son domicile et conservait une liberté d’organisation de son temps de travail.
Les ayants droit se sont pourvus en cassation. Ils soutenaient qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ». Ils considéraient qu’en l’espèce, la Cour d’appel avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en retenant que les tableaux de décomptes du temps de travail produits ne contenaient pas d’éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées.
La Cour de cassation donne raison aux ayants droit du salarié. Elle rappelle qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Elle retient que la Cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur les seuls ayants droit du salarié en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations :
- d’une part, que les ayants droit du salarié présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
- d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Note : La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence antérieure : lorsque le salarié fournit des éléments suffisamment précis à l’appui de ses demandes, l’employeur a l’obligation d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail (Cass. soc., 6 juil. 2022, n° 20-17.287).
Rappel : Pour être valable, une clause de mobilité doit figurer au contrat de travail du salarié, définir une zone géographique précise et ne pas permettre à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc., 2 octobre 2019, n° 18-20.353).
Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’est valable la clause de mobilité portant sur l’ensemble du territoire national (Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-28.916).
En revanche, une clause ne peut être valable lorsqu’elle prévoit une mutation entre sociétés filiales d’un groupe car tout changement d’employeur nécessite l’accord express du salarié (Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44.200).
Une clause de mobilité par laquelle un salarié accepte par avance toute mutation dans une autre société peut-elle être applicable même si la mutation envisagée n’implique pas de changement d’employeur ?
Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.633
En l’espèce, le contrat de travail du salarié comportait une clause qui prévoyait que le salarié « s’engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situés en France métropolitaine ».
En mars 2015, l’employeur a mis en œuvre la clause de mobilité pour envisager une mutation que le salarié a refusée.
Le salarié a alors été licencié pour avoir refusé sa mutation. Il a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement. Selon lui, la clause de mobilité devait être déclarée nulle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont constaté que la clause de mobilité mentionnait les filiales du groupe, lesquelles n’étaient pas énumérées dans le contrat de travail du salarié. Néanmoins, ils ont retenu que la clause n’était pas nulle mais devait être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat. En l’espèce, il avait été envisagé de muter le salarié vers le siège de la société auquel le salarié était administrativement rattaché. Les juges ont donc retenu que l’employeur n’avait fait qu’actionner la clause de mobilité, acceptée sans réserves par le salarié, en vue d’une mutation vers un établissement de l’entreprise à laquelle appartenait le salarié, de sorte que la clause de mobilité ne pouvait être déclarée nulle.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle considère qu’ « en statuant ainsi, alors qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur et que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail a une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Note : Il s’agit d‘une jurisprudence constante de la Cour de cassation : une clause de mobilité par laquelle le salarié s’engage à accepter pour l’avenir toute mutation dans une société du groupe est nulle (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200 ; Cass. soc. 19 mai 2016, n° 14-26.556). Même si la mutation envisagée n’implique pas de changement d’employeur, la clause ne peut s’appliquer.
Rappel : Les conventions de forfait annuel en jours doivent être prévues par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107 ; Cass. soc. 5 octobre 2017, n° 16-23.106).
L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (C. trav. art. L. 3121-60).
A défaut, la convention de forfait jours risque la nullité (Cass. soc. 24 mars 2021, n° 19-12.208 ; Cass. soc. 13 octobre 2021, n° 19-20561).
L’accord collectif qui prévoit, le décompte des jours travaillés ou des jours de repos pris, ainsi qu’un suivi et contrôle mensuel de l’organisation du travail, au moyen d’un système automatisé ou d’un document auto-déclaratif suffit-il à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition du travail dans le temps ?
Cass. soc. 14 décembre 2022, n° 20-20.572
Dans cette affaire, un salarié relevant de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, engagé en qualité de directeur de magasin, a signé une convention de forfait annuel en jours en 2006 sur la base de l’accord de branche du 5 septembre 2003.
En décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de contester la validité de sa convention de forfait en jours. Il soutenait que sa convention de forfait était nulle puisque l’accord de branche ne comportait pas de garanties suffisantes pour assurer le respect des durées raisonnables de travail et des repos.
La Cour d’appel a considéré que la convention de forfait en jours n’était pas nulle car l’accord collectif, en son article 3.2.1. prévoyait :
- un nombre de jours travaillés par année civile ou période de 12 mois consécutifs ;
- le droit à repos dès le premier trimestre suivant en cas de dépassement du plafond ;
- ainsi que le droit au congé annuel complet, au repos hebdomadaire et quotidien.
Les juges ont considéré que contrairement aux affirmations du salarié, il comportait des limites et garanties, soit le contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées, ou de repos/congés.
Formant un pourvoi en cassation, le salarié soutenait qu’un accord collectif qui se contente de prévoir un état récapitulatif du temps de travail mensuel et un contrôle annuel ou bi-annuel, ne garantit pas le respect des durées raisonnables du travail, des repos journaliers et hebdomadaires. Il estimait que la Cour d’appel avait statué en violation de l’article L. 3121-63 du Code du travail alors que l’accord ne comportait aucune précision sur les modalités de contrôle, et qu’il n’était pas caractérisé par un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs du temps de travail.
La Cour de cassation lui donne raison. Elle retient que l’article 3.2.1. de l’accord du 5 septembre 2003, se bornait à prévoir que :
- le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi mensuellement par l’intéressé ;
- les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, de jours ou demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre, et qu’à cette occasion doit s’opérer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application du présent accord et de l’impact de la charge de travail ;
- le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d’un système automatisé, soit d’un document auto-déclaratif et que dans ce cas, le document signé par le salarié et par l’employeur est conservé par ce dernier pendant trois ans et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
La Cour de cassation en déduit que l’accord n’institue pas de « suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable » et « n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ». Elle en déduit que la convention de forfait en jours est nulle.
Note : Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une fois de plus, la nécessité d’être vigilant en cas de mise en place d’un accord collectif prévoyant le recours au forfait-jours, quant au suivi de la charge de travail, notamment en prévoyant expressément des dispositifs de suivi effectifs et réguliers.
Jurisprudence – Relations collectives
Rappel : En principe, les salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel ne peuvent faire l’objet d’un licenciement, individuel ou collectif, sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, pendant toute la durée de leur mandat et au-delà ((C. trav. art. L. 2411-1 et sv.).
L’autorisation administrative de licencier un salarié protégé prive-t-elle le juge judiciaire de son pouvoir de contrôle du respect par l’employeur de ses obligations pendant la période antérieure au licenciement et notamment les actes de discrimination syndicale commis lors de l’exécution du contrat de travail ?
Cass. Soc. 14 décembre 2022 n° 21-16.084
Un salarié exerçant la fonction d’agent administratif était titulaire de divers mandats représentatifs et syndicaux. En 2004, l’employeur a demandé à l’inspection du travail une autorisation de licencier ce salarié pour faute grave. Sa demande a d’abord été refusée par l’inspection du travail, avant d’être acceptée par le Ministre du travail.
Le salarié a été licencié pour faute grave. Il a saisi :
- d’une part, le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement en invoquant des faits de discrimination en lien avec ses activités syndicales et un harcèlement moral ;
- d’autre part, le Tribunal administratif contre la décision du Ministre autorisant son licenciement.
Devant le juge administratif, le salarié a été débouté de tous ses recours. Les juges ont considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le licenciement ait été prononcé en raison de l’appartenance syndicale de l’intéressé.
Devant le juge judiciaire, les juges du fond, qui avaient sursis à statuer en attendant la décision administrative, ont considéré qu’en prenant sa décision d’autorisation de licenciement (question qui, par principe, échappe à la compétence du juge judiciaire au nom de la séparation des pouvoirs entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire), l’autorité administrative compétente avait nécessairement vérifié que la demande en ce sens de l’employeur était d’une manière générale sans lien avec l’exercice par le salarié de ses différents mandats syndicaux.
Il s’en déduit que l’autorité administrative s’était déjà assurée de toute absence de discrimination syndicale, de sorte que la demande indemnitaire du salarié pour discrimination syndicale était irrecevable, que ce soit sur la période antérieure ou postérieure à la délivrance de l’autorisation administrative de licenciement.
Le salarié s’est pourvu en cassation. Il soutenait que si le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère sérieux du licenciement en raison de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, il reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment les actes de discrimination syndicale commis lors de l’exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation fait droit à sa demande. Elle retient qu’en l’espèce, le contrôle exercé par l’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation administrative de licenciement, sur l’absence de lien avec les mandats détenus par le salarié, ne rendait pas irrecevable la demande de celui-ci fondée sur la discrimination syndicale qu’il estimait avoir subie à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail.
Note : L’autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé fasse valoir ses droits devant le juge judiciaire en ce qui concerne l’exécution de son contrat de travail.
La Cour de cassation rappelle ici sa jurisprudence antérieure : lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé mais reste compétent pour examiner les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, notamment l’existence d’une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié (Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-23.028).
Rappel : En application de l’article L. 2315-94 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert habilité « 2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ».
L’article L. 2316-20 du Code du travail précise que le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Cass. soc. 14 décembre 2022 n° 21-22.426
Une société composée de 298 magasins intégrés et de 454 fonds de commerce donnés en location-gérance, est dotée d’un comité social et économique (CSE) central et de 8 CSE d’établissements, dont le périmètre, pour sept d’entre eux, comprend une direction opérationnelle régionale et les magasins intégrés qui y sont géographiquement rattachés et, pour l’un d’entre eux, regroupe les salariés du siège administratif.
En juin 2021, la direction de la société a convoqué le CSE de la direction opérationnelle Ile-de-France (le comité) à une réunion aux fins d’information-consultation sur le projet de la société de passer d’un mode de gestion intégrée à un mode de gestion en location-gérance de neuf magasins.
Lors de cette réunion, le comité a voté une délibération décidant le recours à un expert habilité, au titre d’un projet important.
La société a saisi le président du tribunal judiciaire en annulation de cette délibération.
Le tribunal judiciaire saisi a annulé la délibération au motif que le CSE :
- n’identifiait pas de façon précise et concrète les modifications importantes qui découlaient du passage en location-gérance de chacun des 9 magasins ;
- ne précisait pas en quoi concrètement la location-gérance entraînait des variations d’effectifs, des augmentations ou diminutions de temps de travail ou une redéfinition des postes et des tâches, le transfert des contrats de travail étant encadré par la loi et des garanties sociales spécifiques ayant été négociées et conclues avec les organisations syndicales au sein de l’entreprise avec la mise en place d’une instance paritaire de suivi des passages en location-gérance par accord collectif.
Le comité a saisi la Cour de cassation pour contester cette annulation. Le comité s’est fondé sur l’article L. 2315-94 du Code du travail qui prévoit que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsque l’importance du projet est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité et/ou les conditions de travail des salariés.
Il soutenait que tel est le cas d’un projet de passage en location-gérance par un tiers de neuf magasins de l’enseigne qui étaient exploités directement par la société, entraînant, selon le document d’information remis aux représentants élus, le transfert des contrats de travail de 533 salariés rattachés à ces magasins auprès du locataire-gérant, un mode de gestion différent des magasins et une modernisation des outils de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve l’annulation. Elle retient que le comité en l’espèce ne démontrait pas l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés des magasins concernés.
Législation et réglementation
Pour mémoire, la possibilité de conclure un accord d’intéressement par la voie d’une décision unilatérale de l’employeur était réservée aux seules entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de délégué syndical et sous réserves d’absence d’accord d’intéressement sur les cinq dernières années (L. n° 2020-734, 17 juin 2020).
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a ouvert cette possibilité aux entreprises de moins de 50 salariés, en l’absence d’accord de branche agréé, dès lors qu’elles :
– sont dépourvues de délégués syndicaux et de CSE (dans ce cas, l’employeur doit par tout moyen informer les salariés de la mise en place du dispositif) ;
– ou ne sont pas parvenues à un accord dans leur négociation avec les syndicats ou le CSE (dans ce cas l’employeur doit solliciter l’avis du CSE sur le projet).
Le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 apporte des précisions quant aux modalités d’application de la mesure dans les entreprises concernées. Ainsi, il prévoit que :
- en cas de modification du régime institué par décision unilatérale, l’employeur doit suivre les mêmes modalités que pour la mise en place ;
- lorsque la décision unilatérale intervient après un échec des négociations avec les délégués syndicaux ou le CSE, l’employeur devra déposer le procès-verbal du CSE attestant qu’il a bien été consulté ;
- lorsque la décision unilatérale intervient en l’absence d’instances représentatives du personnel, l’employeur devra fournir un procès-verbal de carence afin de prouver que l’absence de CSE n’est pas de son fait.
Le décret prend également acte de :
- la suppression du contrôle de validité opéré par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur les accords d’entreprise depuis le 1er janvier 2023. Pour les accords déposés à compter de cette date, l’administration délivrera simplement à l’avenir un récépissé attestant du dépôt de l’accord ou du règlement et des autres documents requis ;
- la réduction du délai accordé à l’autorité administrative pour conduire la procédure d’agrément des accords de branche d’épargne salariale, fixé désormais à 4 mois prolongeable de deux mois.
Un décret du 29 décembre 2022, publié au journal officiel du 30 décembre donne des précisions sur le passeport prévention (D. n° 2022-1712 du 29 décembre 2022, JO 30).
Pour rappel, le passeport de prévention a été créé par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, dite « loi Santé au travail ». Il vise à recenser l’ensemble des attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre de formations dispensées par l’employeur ou par un organisme de formation, en matière de santé et sécurité au travail.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont précisé la finalité du Passeport de prévention. Celui-ci devra « rester un outil au service des employeurs et des salariés ; il doit faciliter la circulation entre eux de l’information sur les formations suivies, les compétences acquises et les certificats obtenus ».
Ainsi, le passeport prévention ne doit pas être « un moyen de contrôle des compétences des salariés », ni « constituer un prérequis obligatoire à tout recrutement des salariés » ou « avoir pour finalité d’être un outil de contrôle des formations dispensées par l’employeur » ou encore « être confondu avec les droits du salarié attachés au CPF même s’il est intégré dans le même système d’information ».
Alimentation du passeport prévention
Le passeport prévention doit être renseigné par :
- l’employeur, pour les formations qu’il organise ;
- les organismes de formation, pour les formations qu’ils dispensent ;
- le salarié, pour les formations suivies à son initiative.
Le Passeport prévention vise également les demandeurs d’emploi, qui pourront en ouvrir un et l’alimenter.
Contenu du passeport prévention
Le passeport prévention comprend les attestations, certificats et diplômes dispensés en interne au sein de l’entreprise, y compris à l’étranger ou en externe par le biais d’organismes de formation en matière de santé et sécurité au travail.
Calendrier de mise en œuvre
- Avril 2023 : le passeport sera ouvert pour les travailleurs, via un espace personnel dans lequel ils pourront renseigner leurs parcours et attestation ;
- 2023/2024 : le passeport sera ouvert aux employeurs, déclaration des données ;
- 2024 : les employeurs pourront consulter les passeports de prévention.
Rappelons qu’en octobre dernier un site d’information a été mis en ligne. Il est déjà accessible via le site suivant : https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr.
Mise à la disposition de l’employeur
Le passeport prévention est en principe, géré par le salarié. Il peut ainsi décider du contenu qu’il souhaite rendre accessible à un employeur.
Un arrêté à paraître fixera les modalités et conditions d’accès au passeport (dont l’accord total, l’accord partiel, ou le refus d’accès).
Pour optimiser la visibilité de l’employeur sur les formations qu’il a dispensées ou fait réaliser par un organisme de formation, il est prévu que l’employeur pourra activer un espace dédié d’information auquel seul lui ou son délégataire pourra accéder.